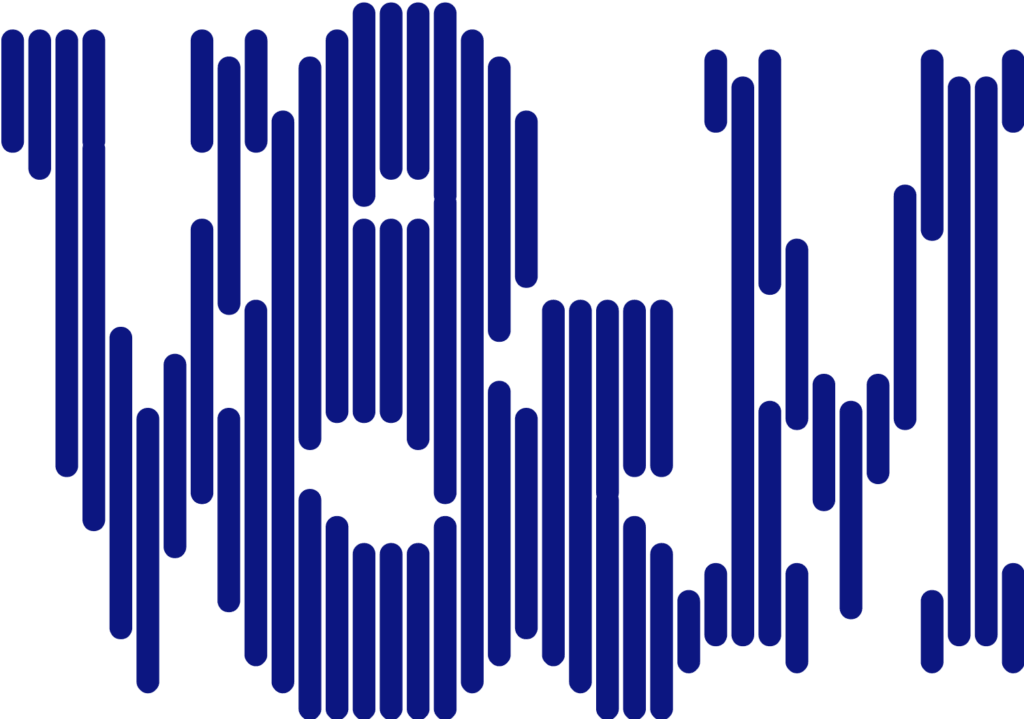Le bégaiement à l’écran

Le 21 mai 2025, au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal, avait lieu « Le bégaiement à l’écran », une soirée de projections et d’échanges autour de la représentation du bégaiement dans les films, y compris un panel avec Judith Labonté, orthophoniste, et Renaud Ouimet, personne qui bégaie et cinéaste. L’événement s’inscrivait dans la programmation de Voix et Médias, qui propose des espaces pour réfléchir collectivement aux voix marginalisées par des différences communicationnelles dans les médias.
Il s’agissait du deuxième événement public de cette programmation, après une première soirée de création collective autour de Cadavre exquis, un cycle de conférences-projections conçu par le professeur André Habib, consacré aux collections de films en 16mm de l’Université de Montréal.
Trois extraits de films ont été présentés pour alimenter la réflexion. Chaque extrait a été sélectionné pour illustrer des manières contrastées de représenter le bégaiement à l’écran, en s’appuyant sur les typologies développées par Clogston (2010) et Haller (1999).
- Dans My Cousin Vinny (J. Lynn, 1992), le bégaiement est utilisé comme ressort comique dans une scène de procès. Cette approche s’inscrit dans ce que les auteur·rices qualifient de représentations traditionnelles, où le handicap, dans ce cas-ci la disfluidité, est souvent ramenée à une faiblesse, un obstacle ou un trait ridicule.
- Confessions (L. Picard, 2022) adopte une approche plus nuancée, associée aux modèles dits progressistes. Le film, inspiré de faits réels, présente un personnage principal qui bégaie, sans chercher à expliquer ou justifier son bégaiement. L’acteur et réalisateur Luc Picard a d’ailleurs appris à reproduire cette disfluidité en s’inspirant d’enregistrements d’interrogatoires. Ici, le bégaiement est intégré comme une composante de l’identité, sans en faire le centre du récit.
- Enfin, Le Bon souffle (R. Ouimet, 2022) offre une forme d’auto-représentation. Réalisé par une personne qui bégaie, ce court-métrage propose une exploration sensorielle et incarnée de cette expérience. Bien que l’acteur principal n’ait pas de disfluidité, il a été coaché par le réalisateur afin de rendre l’expérience de la parole disfluente de manière crédible et respectueuse. Plusieurs personnes dans la salle ont partagé à quel point le film leur avait permis de « vivre le bégaiement de l’intérieur ».
Chaque extrait était accompagné d’un contexte proposé par Geneviève Lamoureux, doctorante en orthophonie et personne qui bégaie, qui animait également le panel qui a suivi la projection des extraits. Dans le panel, le cinéaste Renaud Ouimet a généreusement partagé son processus de création et ses réflexions personnelles sur l’auto-représentation. Judith Labonté a offert un complément en lien avec le potentiel thérapeutique de certaines représentations.
Le public, engagé et participatif, a particulièrement réagi à Le Bon Souffle, soulevant des questions sur l’identification, les nuances de la représentation et les effets durables de certaines images. L’échange s’est prolongé dans une atmosphère conviviale autour d’un verre, dans un sympathique pub près de l’Université.
Même si nous n’avons pas de photos claires du public, merci à toutes les personnes présentes pour leur écoute, leur curiosité et leurs réflexions profondes. Ces espaces sont rares, et leur richesse dépend de celles et ceux qui les habitent.
📽️ Pour voir Le Bon souffle : https://www.tv5unis.ca/le-bon-souffle



Réf. : Clogston, J. S. (1990). Disability Coverage in 16 Newspapers. Louisville: Advocado Press.
Haller, B. (1999). “How the News Frames Disability: Print Media Coverage of the Americans with Disabilities Act.” Research in Social Science and Disability. JAI Press, Vol. 1.