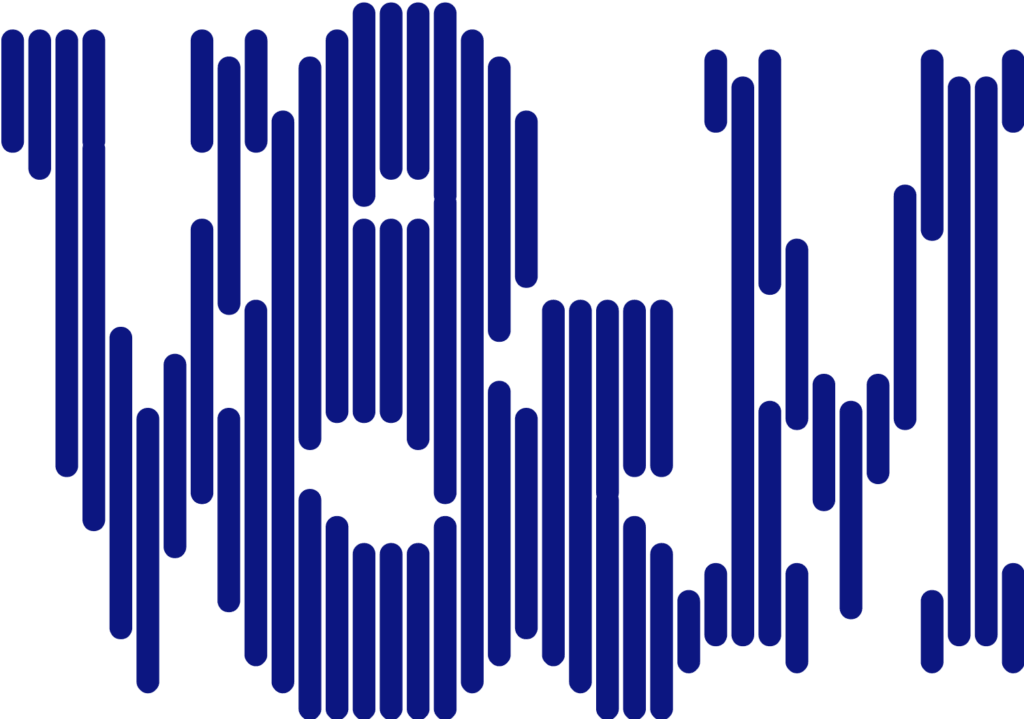Pourquoi ce festival?
Le Festival Voix et Médias est né d’un besoin : mieux comprendre, représenter et mettre en lumière les réalités des personnes présentant des différences communicationnelles. Trop souvent, ces expériences sont abordées uniquement sous l’angle du « problème », du « trouble ou du « déficit ». Pourtant, ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce que l’on montre, influence aussi ce que l’on ressent, ce que l’on croit possible, ce que l’on devient.
« You can’t be what you can’t see. »
— Marian Wright Edelman
Je m’appelle Geneviève Lamoureux. Je suis une personne qui bégaie.
Je suis aussi orthophoniste et doctorante en sciences de l’orthophonie, sous la direction d’Ingrid Verduyckt, Ph.D., et Lucie Ménard, Ph.D. Avec toute une équipe, j’organise le Festival Voix et Médias.
Pendant longtemps, j’ai tout fait pour ne pas bégayer. Jusqu’à 22 ans, j’ai masqué mon bégaiement avec acharnement, au prix d’un inconfort quasi constant, d’un mal-être silencieux. J’avais honte de ma manière de parler. J’avais intégré très profondément que le bégaiement n’était pas le bienvenu. Qu’il fallait le corriger pour « réussir » dans certains (de nombreux) milieux, ou simplement pour être entendue, respectée.
Ce qui me manquait, c’était des repères. Des images. Des modèles. Dans les médias, dans mes cours, dans les arts, dans la société… je ne voyais pas de personnes qui bégaient. Ou alors, c’étaient des caricatures, des pathologies.
Bref, je ne connaissais qu’une seule façon de voir le bégaiement : comme quelque chose d’indésirable.
Puis un jour, aux Pays-Bas, j’ai rencontré d’autres personnes qui bégaient (je raconte cette histoire ici et ici). Et pour une des premières fois, je me suis sentie à la maison, avec le bégaiement. Il y avait là des gens très différents, avec toutes sortes de manières de bégayer, de parler, d’être. Des bégaiements audibles, discrets, changeants. Des personnes extraverti·es, posé·es, flamboyant·es, réservées. Le bégaiement n’était pas une seule chose : il devenait pluriel. En découvrant ces voix, j’ai pu commencer à entendre la mienne autrement.
Quelques années plus tard, à 28 ans, j’ai décidé de devenir orthophoniste. Et là encore, la représentation a été décisive : voir d’autres orthophonistes qui bégaient m’a permis d’imaginer que moi aussi, je pouvais en être une.
Aujourd’hui, je mène une recherche doctorale sur la représentation des différences communicationnelles. Parce que je crois fermement qu’il n’y a pratiquement jamais une seule façon de voir les choses.
C’est dans ce parcours que le Festival Voix et Médias a vu le jour.
Dans les années précédant ce festival, j’ai été en contact avec des idées qui m’ont nourrie. Par exemple, à Londres, en 2023, lors de l’événement « Stammering Pride Against Prejudice », tenu au City Lit College. Ce jour-là, j’ai découvert le concept de Transformative Belonging, proposé par St. Pierre et Jorgensen Skakum (2025).
Dans leur travail, St. Pierre et Jorgensen Skakum décrivent trois modes d’appartenance qui structurent la manière dont les personnes qui bégaient sont accueillies (ou non!) dans notre société :
- Curative : l’appartenance est conditionnelle à la correction. Il faut cacher, compenser, « améliorer » ce qui est vu comme un défaut.
- Inclusive : la différence est tolérée, mais sans que les structures ou les normes ne changent. On permet à une personne qui bégaie d’être là, mais sans transformer les espaces pour qu’elle puisse y exister pleinement. Le bégaiement est alors vu comme interférant avec la manière typique de faire les choses (par exemple, on accorde plus de temps pour une présentation).
- Transformative : la différence est reconnue comme enrichissante et générative. Ce n’est pas à la personne de changer, de masquer, c’est au monde de s’ouvrir, de se réimaginer à partir d’elle.
Et si, au lieu de simplement tolérer les voix disfluentes, on les accueillait comme des formes de présence qui transforment nos espaces collectifs?
Ce jour-là, j’ai aussi découvert le travail de JJJJJerome Ellis, artiste multidisciplinaire (qui performera d’ailleurs au festival le 8 novembre!). Dans son livre The Clearing, il compare ses blocages à des clairières : des espaces de lenteur, de respiration, de rupture fertile, dans un monde obsédé par la vitesse. Il relie ces clairières à l’histoire de ses ancêtres afro-américains, qui se réfugiaient dans la forêt pour chanter, résister, exister autrement, loin des maîtres et de l’esclavage. Le bégaiement peut aussi devenir un moment pour se poser. Une invitation à exister autrement, dans son propre temps.
Ces représentations ont élargi mon imaginaire. Elles m’ont rappelé à quel point ce que l’on voit, entend, raconte, façonne ce que l’on croit possible. On a besoin de voir pour imaginer.
Le bégaiement peut être toutes ces choses : parfois difficile, parfois neutre, parfois générateur, lumineux, collectif. Et tout ça mérite d’être représenté.
Avec des allié·es du milieu clinique, communautaire, artistique et académique, nous avons rêvé d’un espace public vivant pour réfléchir collectivement à ces images.
Le Laboratoire d’innovations en orthophonie (Labo IV) et le Labo CinéMédias ont uni leurs forces pour donner naissance à ce projet, avec le soutien du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).
Découvrez nos partenaires qui rendent ce festival possible.
Le bégaiement occupe une place centrale dans cette première édition, non pas comme une exclusivité, mais comme un point d’entrée. Le festival explore aussi d’autres réalités encore trop peu représentées : l’aphasie, l’autisme, la dyslexie, la Tourette, la sourditude, et d’autres manières de communiquer perçues comme atypiques.
Ce que ce festival cherche à construire?
Un monde qui fait plus de place aux diverses formes d’humanité.
Un monde où on peut, un peu plus, toustes se reconnaître.
Bon festival!

Geneviève Lamoureux est doctorante en sciences de l’orthophonie et de l’audiologie à l’Université de Montréal, où elle est membre du Laboratoire d’innovation en orthophonie ainsi que du Laboratoire CinéMédias. Personne qui bégaie, elle centre ses recherches sur la diminution de la stigmatisation liée au bégaiement et aux différences communicationnelles. Elle s’intéresse aux liens entre représentation, pouvoir et inclusion. Dans le cadre de ses travaux, elle a initié la création de nouvelles représentations médiatiques du bégaiement, notamment en produisant « Le public, c’est nous » (sortie prévue en novembre 2025), un court-métrage collaboratif mené avec plusieurs organismes partenaires. Le Festival Voix et Médias s’inscrit dans la continuité de son projet doctoral, en tant qu’espace de création, de diffusion et de réflexion collective.
Référence : St Pierre, J., & Jorgensen Skakum, D. (2025, March). Towards a World that Stutters: Dysfluency in Three Modes of Belonging. In Symposium: Canadian Journal of Continental Philosophy/Revue Canadienne de Philosophie Continentale (Vol. 29, No. 1).